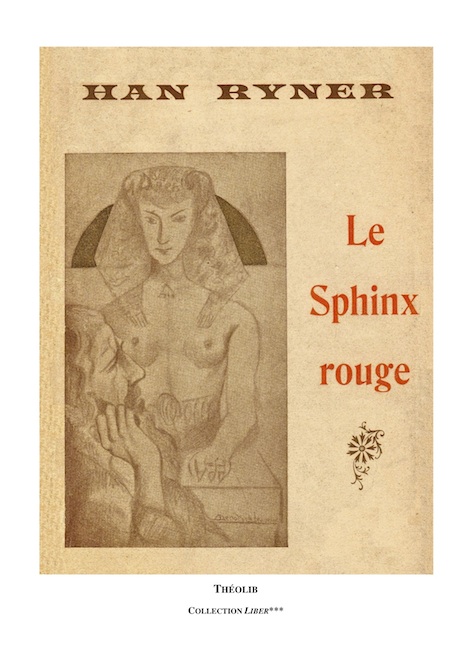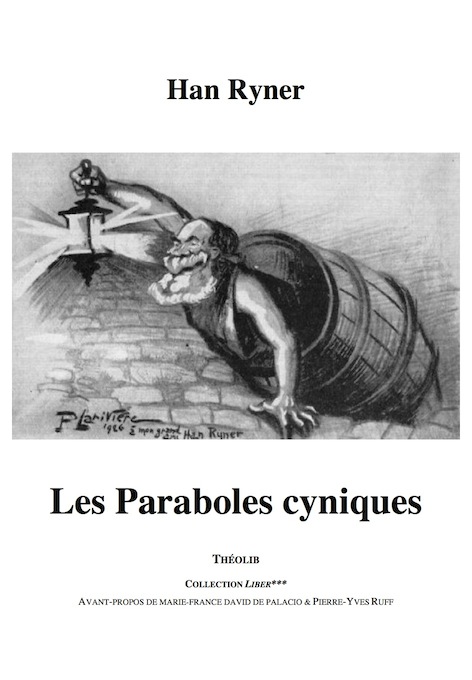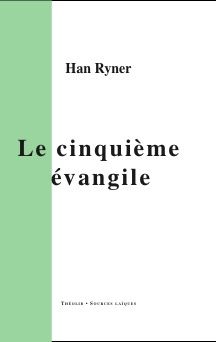[Avant-Propos] [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] [XI] [XII] [XIII] [XIV] [XV] [XVI]
Chapitre VIII
Guérison du corps. — La grosse Célina.— Interrogatoire direct.— Attitude de Gabrielle. — L'accent de la vérité. — La mort accusatrice.
Hélas ! je perdis bientôt tout espoir de mourir. Et voici que je me raccrochai à la vie, âprement, dans un besoin de savoir. Non pas une nécessité de connaître le fait de la trahison : en pouvais-je douter encore ? Mais une soif d'avaler goutte à goutte toute l'amertume fangeuse du détail.
Pendant ma longue convalescence, je fis taire mon âme. Je n'avais pas encore le courage de commencer l'affreux combat ; je ne me trouvais pas la force d'imposer la vérité à la menteuse.
Quand je fus guéri complètement, le désir me chatouilla de jouir de la vie facile. Je devrais me séparer de Gabrielle sans explication, éviter l'avilissement inutile d'une discussion. Puisque j'étais certain de son indignité, je n'avais, pour m'affranchir de la souffrance et de la honte, qu'à la renvoyer ou mieux à la laisser ici et à disparaître moi-même. Mes goûts modestes me permettaient de diviser mes revenus en trois parts égales, de laisser les deux tiers à mon enfant et à sa mère, de vivre en garçon très à son aise avec le reste. Qui sait si je n'aimerais pas de nouveau ; si, moi qui n'avais pu trouver l'épouse véritable, je ne rencontrerais pas une amante vierge, digne de mon cœur ? J'aurais la tristesse de ne plus apporter un passé intact à celle qui me donnerait la fraîche nouveauté de ses sensations. Mais les hommes qui n'aiment qu'une fois sont si rares. Tous mes camarades avaient perdu leur virginité avec des femmes mûres ou avec des courtisanes. Je leur ressemblais sur ce point ; une trahison avait rendu vains mes efforts vers l'absolue noblesse, m'avait empêché d'être une exception de beauté, m'avait rejeté dans la règle d'ignominie. Etait-ce de ma faute ? Sans doute, j'avais été naïf excessivement. Mais peut-on sortir de la naïveté autrement que par l'expérience ? J'avais cru éviter l'inévitable cercle. Je m'y trouvais enfermé, avec tous les hommes. Soit. Mais je voulais oublier le passé nécessaire et infàme, m'élancer vers l'avenir de joie et d'amour.
Je partis en prétextant un besoin de distraction et d'isolement. Je déclarai que j'ignorais but, itinéraire,date de retour. J'avais l'air si sombre, si fou mélancoliquement, que ma femme n'opposa aucune objection, retint même ses larmes.
J'allai à Paris. En chemin de fer je m'affirmai que, pour éviter une nouvelle erreur, il fallait, avant de chercher la perle rare, acquérir de l'expérience, traverser une période de « noce ». D'ailleurs — je l'avais lu quelque part — les. femmes les plus pures sont attirées vers les débauchés, peut-être par une inconsciente curiosité perverse, peut-être parce que le miracle d'une conversion leur paraît le grand triomphe de la beauté et de la vertu. Donc je deviendrais débauché pour augmenter mes chances de rencontrer l'amour chaste, pour donner la tentation de me convertir; je deviendrais débauché par amour de la pureté.
Certes, des répugnances me soulevaient quand ma résolution se traduisait en images physiques, quand je me voyais entre des bras qui s'étaient ouverts à tant d'autres hommes, buvant des lèvres que tant d'autres lèvres salirent. Mais je me répondais :
— Bah ! une putain ou beaucoup de putains, qu'importe ?
Le soir même de mon arrivée, je vaguais sur les grands boulevards, mélancolique chercheur d'ignominies. Toutes les filles rencontrées me semblaient trop laides. Je voulais que, du moins, la hideur de l'âme fût recouverte d'un corps et d'un visage admirables. Puisque je me contentais de la chair, j'exigeais tout son charme prenant ou toute sa splendeur terrassante. Je ne rencontrais, hélas ! ni éblouissement, ni attirance ; ni le langage persuasif de la grâce, ni l'irrésistible éloquence de la beauté.
Fatigué d'errer à chercher qui me dévorerait, j'entrai dans un café. Une femme y était, assise devant un bock vide. J'eus un petit frisson d'admiration devant sa parfaite beauté animale. Ses grands yeux souriants n'exprimaient que la joie naïve de vivre, de se bien porter, de ne plus peiner à gagner le pain quotidien, de donner seulement une nuit de temps en temps et d'être payée pour avoir consenti à des plaisirs. Ses chairs, presque surabondantes, étaient si blanches, paraissaient si fermes !... et sa chevelure rousse lui faisait un casque d'or merveilleux. Je la résumai de ce mot rapidement pensé : « Un Rubens presque sobre. » Je me sentis pénétré par le désir de me rouler sur cette opulente créature, d'étouffer dans toute cette blancheur mes souvenirs angoissants, de chercher sur la fermeté souple de ces chairs, comme en un canapé aux élastiques et solides ressorts, le bon sommeil d'oubli.
Je m'assis en face d'elle, avec un salut qu'elle me rendit. Et nous causâmes. Oh ! l'abondante sottise de ses paroles ! Elle m'expliqua qu'elle aimait l'Empire parce qu'aujourd'hui les affaires marchaient bien ; je louai ses sentiments de patriotique reconnaissance. Quelques instants, sa bêtise et mes ironies incomprises m'amusèrent. Bientôt, je songeai, malgré moi, à Gabrielle, si fine, si spirituelle. Et voici qu'en mes mains, en mes jambes, en mes lèvres, je sentis des frémissements de souvenirs ; comme un coffret sur un trésor, mes yeux se fermèrent sur la vision des lignes adorablement sobres, d'un dessin si pur et si noble. Le Rubens me parut lourd, matériel, bête de corps autant que d'esprit.
J'avais changé de place. J'étais près d'elle sur la banquette. Peut-être parce que je la voyais moins et que je la touchais, du dégoût lentement montait en moi. Et pourtant, sous les vêtements voyants comme une enseigne raccrocheuse, je les sentais fermes divinement, les chairs dont l'abondance me déplaisait. Nous étions seuls dans ce café où elle était entrée « se reposer un moment, sans compter le moins du monde rencontrer quelque chose à faire ». Elle s'assit sur mes genoux. Je me laissai envahir, désolé de son poids.
— Devine combien je pèse, interrogea-t-elle glorieusement.
— J'ai assez de sentir sans deviner.
— Ah ! mon petit, tu as beaucoup d'esprit, toi, et tu es tout plein joli. Tu dois être très riche ?
— Ton admirable logique ne te trompe pas.
Elle regarda mes yeux avec inquiétude :
— Je crois que tu te fous de moi..
Et, devant la réponse de mon sourire agrandi :
— Ça n'y fait rien, je te gobe.
Elle m'embrassa sur les lèvres.
— Et puis, conclut-elle, quand tu auras couché une fois avec moi, tu ne te foutras plus de ta grosse Célina.
De nouveau ses lèvres chaudes appuyaient sur mes lèvres.
La porte du café s'ouvrit. Célina se rassit sur la banquette, souriante ; dans ses yeux luisait une malice faite de confiance en soi. Nous nous tûmes un moment, ses regards de triomphe luttant avec la moquerie de mes regards. Puis :
— Si nous allions au dodo, mon petit ?
J'appelai le garçon pour payer, prêt à me lever en offrant le bras à « ma grosse Célina ». Mais elle se pencha à mon oreille :
— Tu sais, chançard, j'ai envie de jouir et tu vas trouver un pucelage de quinze jours.
Le dégoût fut trop fort. Elle me rappelait trop directement les autres hommes qui... Je répondis, ironique :
— Je suis trop fatigué pour tant de bonheur J'arrive de voyage. Demain, je serai sans doute plus dispos.
— Moi, j'ai envie de toi maintenant, et demain peut-être je ne te goberai plus.
Vaincu d'étonnement, je me laissai emmener. Plusieurs fois, en chemin, je fus tenté de me délivrer. Je m'objectai toujours que je ne trouverais pas mieux et que, puisque j'étais décidé... Je savais ce que je voulais, peut-être ! je n'étais plus un enfant. Ainsi l'amour-propre m'empêchait de me dédire,d'abandonner sans commencement d'exécution mes projets de débauche. Je m'affirmais d'ailleurs que le dégoût disparaîtrait bien vite. Je n'étais pas plus bête qu'un autre et je saurais jouir des biens que tous recherchent. Sans compter que j'étais fier parce que les passants se retournaient pour regarder l'admirable fille qui me donnait le bras. L'un d'eux mémo, un vieillard s'écria :
— Nom de Dieu, le beau Rubens !
Mais son compagnon, tout jeune, avec une moue à demi satisfaite :
— J'aime ce qui est complet. Pas assez opulente pour un Rubens, la belle Célina.
Elle me demanda :
— Qu'est-ce qu'ils ont tous à parler de Rubens en me regardant ? C'est-y une femme qui me ressemblait, Rubens ?
Je déclarai qu'elle avait deviné et j'admirai sa pénétration.
— Toi, dit-elle, on ne sait jamais si tu te fous du monde. Mais tu ne te foutras pas de mes caresses, c'est moi qui te l'assure.
Je songeais, avec les mots mêmes de Célina : « On ne sait jamais si la femme qu'on aime se fout du monde. Et pourtant on ne se fout pas de ses caresses. »
Car les souvenirs fourmillants de mes doigts, de mes seins, de mes jambes, irritaient en moi des désirs qui allaient bien loin, là-bas, vers Gabrielle. J'aurais voulu tenir le bras de Gabrielle, la mener au « dodo », la déshabiller de mes mains tremblantes, m'agenouiller devant sa nudité d'un si pur dessin, faire ramper devant elle des injures et des adorations : « Pardonne moi de savoir que tu es une putain. Je t'aime quand même. Et je ne puis aimer que toi. »
Quand je fus couché avec la grosse Célina, ses caresses m'ennuyèrent d'abord. Mais je fermai les yeux, et mes mains et mes seins, et mes cuisses furent contents, infidèles plus facilement que le regard. Et j'acceptai le baiser, le retins, le prolongeai, le rendis.
Tout à coup, dans la joie de mon corps, évocatrice de tant d'autres joies, je laissai échapper un cri heureux :
— Oh ! Gabrielle !
Mais j'ouvris les yeux. J'avais la joue brûlante d'un soufflet, et le corps d'où venait mon plaisir m'avait repoussé d'un brusque mouvement indigné. Et des mains me bousculaient, des paroles aussi :
— Va-t-en, cochon ... Pour qui me prends-tu ?...C'est trop se foutre du monde, à la fin !... Parce que je te gobais, tu m'en récompenses comme ça ... Allons, vite, hors du pieu, salaud.
Je me levai, m'habillait vivement. Prêt à partir, j'ouvris mon porte-monnaie.
— Non, je ne veux pas de ton argent, cochon. Fais un cadeau de ma part à ta putain deGabrielle.
Alors, j'eus envie, follement, de cette fille qui me repoussait, qui m'injuriait, qui m'injuriait dans la femme que j'adorais et que je haïssais :
— Je te veux, je t'aime... C'était pour voir ce que tu dirais ... Je t'ai dit le premier nom venu. Je ne connais personne qui s'appelle Gabrielle... Pardonne-moi cette mauvaise plaisanterie qui me montre que tu me gobes vraiment, qui fait que je t'aime tout à fait.
Je tremblais, comme si la conquête à refaire en eût valu la peine. Cette grosse personne avait de courtes colères, de promptes indulgences :
— Soit, reviens, vilain pierrot. Mais, si tu recommences, tu sais, je cogne, absolument comme si tu étais un sale républicain.
Je ne recommençai pas. Mes yeux restèrent ouverts, se donnèrent la joie âcre de l'infidélité à celle que mon mépris et ma haine ne pouvaient me faire cesser d'aimer. Je me dis que Célina valait mieux que Gabrielle. Avec la femme à tout le monde, au moins, je n'ignorais pas à qui j'avais affaire. Elle me donnait de la franchise. Je lui en étais reconnaissant. Et mon orgueil, humilié de l'infidélité de Gaby, se satisfaisait au caprice de la grosse Célina.
Moi, l'affamé de pureté, je laissai mon corps aimer toute cette nuit, aimer en toute passion, en tout élan, ce corps splendide et banal.
Le matin, je rentrai à l'hôtel, brisé de fatigue et de tristesse. Célina m'avait fait promettre de dîner chez elle. Mais j'étais bien résolu à ne plus la voir, à ne plus voir personne. Je m'enfermai dans ma chambre comme un moine en sa cellule. Pendant cinq jours, je ne sortis pas une seule fois. Puis j'envoyai chercher un cabriolet et je pris le chemin de la gare.
De mes sombres réflexions il résultait, en effet, que j'aimais irrésistiblement Gabrielle ; que toute jouissance du corps la rappelait douloureusement à mon imagination ; que d'ailleurs son moment d'oubli ne constituait pas une faute ; qu'elle avait eu raison de ne m'en rien dire, de me laisser dans le sommeil d'ignorance où elle me croyait ; qu'enfin je souffrirais épouvantablement loin d'elle. Sans doute, je souffrirais presque autant auprès d'elle fermée, revêtue de mensonge et de silence. Mais son aveu me soulagerait de tout cet écrasant passé lointain, me permettrait de l'aimer sans trouble dans le passé récent, dans le présent, dans l'avenir, nous unirait ineffablement par ma compréhension, par ma pitié et par sa confiance ; nous ferait communier en un regret commun, aussitôt effacé, raturé d'oubli, de se sentir partagé.
Certes, il resterait un poids sur mon bonheur. Mais ce couvercle de mélancolie l'empêcherait de s'évaporer, concentrerait notre joie.
Combien de ménages devaient ressembler au mien par l'erreur initiale, par le faux départ. Ils n'en laissaient rien paraître au dehors, s'apaisaient bientôt, sans doute, en l'acceptation de l'irréparable. Il ne faut pas s'acharner contre le fait accompli et, — si la cruelle imagination ne l'évoque pas à chaque instant, ne reconstruit pas un éternel cauchemar avec ce qui, sans elle, serait bien fini, — il n'est un obstacle ni à la vie harmonieuse, ni à la joie profonde, ni au plaisir léger. Le coup d'état m'empêchait-il de plaider devant les juges de Monsieur Bonaparte, de m'intéresser aux affaires de mes clients, de trouver des arguments qui m'amusaient et qui triomphaient ? Est-ce que je vivais hypnotisé par le massacre du boulevard Montmartre ? Pourquoi me préoccuperais-je davantage d'un événement sur lequel personne ne pouvait plus rien et qui n'avait d'importance que de préjugé ? Gabrielle m'aimait et je l'aimais : voilà les deux points intéressants. Que pouvait me faire la hardiesse triomphante de ce Bertrand qu'elle méprisait aujourd'hui, ou une faiblesse inexplicable pour elle-même et dont le souvenir lui était une torture ?
Je faisais effort pour sentir ainsi. Mais, sitôt l'aveu obtenu, il me semblait bien que ces sentiments seraient en moi naturels et spontanés. La fleur de pitié ne germait qu'avec peine en mon cœur refroidi de silence ; mais, que le soleil de sincérité vînt à briller, elle se dresserait, puissante, étouffant les herbes mauvaises.
Gabrielle montra de la joie de mon retour et de mon sourire. Quand nous eûmes pris ensemble un repas réconfortant, je l'entraînai, persuasif, dans la bibliothèque et je lui dis :
— Ma chérie, c'est un dialogue grave qui commence entre nous, une conversation d'où sortira notre bonheur... Ne m'interromps pas... Je sais que tu m'as trompé...
Un étonnement agrandit ses yeux. Elle répéta :
— Je t'ai trompé ?...
— Non, mon amie, je m'exprime mal. Tu ne m'as pas trompé, puisque ton « moment d'oubli » précéda notre mariage.
— Stanislas, est-ce que tu veux me rendre folle ?
Et ses yeux affirmaient qu'elle ne comprenait pas mes paroles, que leur sens littéral, impossible, l'ahurissait.
Je sentis que j'allais trop vite. Certaines choses, que je me proposais d'exposer après, devaient être dites avant. Je m'empressai :
— Ecoute, mon adorée, le mot qui dénouera ton angoisse. Ta faute est pardonnée depuis longtemps. Ou plutôt je n'ai pas eu a pardonner ; j'ai souffert avec toi. Et je viens te supplier aujourd'hui de m'aider à guérir notre commune souffrance.
Elle s'effarait de plus en plus.
— Stanislas, cria-t-elle, dis-moi vite que tu n'es pas fou.
— Je ne suis pas fou, tu le sais bien.
— Alors, que signifie cette absurde plaisanterie ?
— Je ne plaisante pas.
— Tant pis ! Faut-il donc que je t'écoute sérieusement ?
— Oui, et que vous me répondiez de même.
— Oh ! je vais répondre avant. Après, je n'aurais plus la force... Stanislas, par mon amour pour vous et sur la tête de notre petit Stani, je jure que j'ai toujours été digne de vous. Vous êtes mon seul amour...
—Je le sais, ma chérie.
— Et bien ! alors ? ...
— Une surprise de ton ignorance. Une stupeur paralysante devant la hardiesse d'un misérable. Une ignoble manœuvre de ta mère...
—Oh ! Stani...
Et elle fondit en larmes.
— Tu vois, dis-je, cruel, que je viens de toucher juste.
Elle sanglota :
— Mon pauvre ami, je te pardonne. Ou plutôt, pardonne-moi. Il y a, en effet, de ma faute. J'aurais dû te dire tout immédiatement, t'éviter la torture du soupçon. Car je comprends maintenant quel fut ton mal en ces jours où tu disais que tu n'avais rien. Je comprends que je suis coupable de ton duel, et de ta blessure, et de ta longue maladie. Je comprends combien mon silence t'a fait de mal.
Il me sembla que mon horrible soif commençait à s'apaiser à une eau bourbeuse. Courbé de pitié sur mon âme et sur la sienne, j'espérai l'étancher tout à fait, ma soif, assez pour l'oublier, elle et l'écœurant liquide nécessaire. Et je dis, très doux :
— Ne pleure pas sur moi, mon adorée, ni sur toi. Car nous nous aimons depuis toujours et pour toujours. Ta confession va enfin nous guérir du seul mal qui troublait notre joie. Ton aveu sera pour tous deux le grand soulagement. Il rejettera au bord de notre route le fardeau vite dépassé, vite oublié dans notre marche heureuse. Exprimer le passé suffira à le supprimer.
Elle reprit, tête basse, corps tremblant :
— Eh bien ! écoute, mon ami. Pendant que tu étais à Jersey, Bertrand,— qui avant toi m'avait fait la cour et que j'avais repoussé plutôt durement, car toujours il me déplut, — vint souvent à la maison. Il me parlait de toi, m'attendrissait, puis cherchait à m'effrayer en prétendant que tu m'oubliais certainement. Je répondais que j'étais sûre de mon cher Stanislas et que, si tu m'abandonnais, j'abriterais en un couvent les débris de mon cœur. Mais il riait, cherchait à me faire rire, affirmait qu'une belle fille avait toujours d'autres ressources que le couvent, que tous mes amoureux n'étaient pas en exil. Et ses protestations déplaisantes recommençaient. Ma mère disait comme lui.
Je criai :
— Ta mère disait comme lui !
— Ne te fâche pas, mon ami. Je vais te l'avouer toute, cette honte, que je n'ai pourtant pas le droit de dévoiler, peut-être. Ma mère, d'abord, disait toujours comme lui. Puis elle parla tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Parfois ses yeux le regardaient avec de jalouses supplications, me regardaient avec une haine jalouse. Et je finis par deviner qu'elle était sa maîtresse. Ah ! si tu savais comme je pleurai quand je compris...
— Et puis ?...
— J'écrivis en cachette à mon grand-père que je serais heureuse d'aller passer quelque temps auprès de lui. Il s'empressa de m'inviter et je courus à Lyon. J'y reçus bientôt une lettre de Bertrand : il me déclarait un irrésistible amour et me priait de consentir à être sa femme. Des lignes de ma mère me conseillaient aussi de renoncer à un rêve précaire et d'accepter une réalité avantageuse. Le lendemain, nouvelle lettre de Bertrand, plus pressante que la première. Et le manège continua tous les jours pendant une semaine. J'écrivis « non » deux fois et laissai sans réponse les autres insistances. Je renvoyai la dernière enveloppe sans l'ouvrir. Alors m'arriva la lettre où vous me demandiez d'aller vous épouser à Jersey. Ma mère, en même temps, m'affirmait que vous étiez fou de montrer de telles exigences. Je répliquai : « J'aime M. Stanislas. Je n'ai d'autre volonté que la sienne. Invite-le à faire les formalités et à nous indiquer le jour où nous devrons arriver. »
— Ah !
— Je comprends ton étonnement, mon chéri : j'ai su depuis que ma mère, peut-être forcée par Bertrand, avait écrit tout autre chose. Je n'avais jamais osé t'avouer son mensonge. Seulement, en certains jours douloureux, je songeais que je n'avais ni le droit de t'épouser sans te dire tout ce qui concernait ma famille, ni le droit de dévoiler la honte de ma mère : la seule solution était de renoncer au monde et à l'amour, de m'enterrer vivante dans un couvent, d'offrir mon bonheur à Dieu en échange du salut de ma mère... Hélas ! je t'aimais trop, Stani. Je n'ai pas eu le courage. J'ai laissé faire la vie qui semblait vouloir me rendre heureuse. J'ai été làche. Je t'ai trompé. Me pardonnes-tu, mon adoré ?
Elle me prenait la main, la couvrait de baisers et de larmes. Et elle suppliait encore :
— Dis-moi que tu ne m'en veux plus.
Je demandai :
— Ce sont tous les aveux que tu as à faire ?
Elle eut de nouveau son regard admirablement agrandi d'étonnement :
— Que veux-tu qu'il y ait de plus ? C'est bien assez, c'est bien trop.
Et des sanglots éclatèrent.
— Ce n'est rien, repris-je. Dis le reste, ce qui est important, ce qui te concerne personnellement. Je pardonnerai tout ce que tu avoueras aujourd'hui, si grave que ce soit. Mais songe que je sais tout et que ce que tu essaierais de cacher en ce moment, je ne le pardonnerais jamais.
Elle se releva, les yeux secs subitement.
— Si tu savais, tu saurais qu'il n'y a rien de plus. Je veux ignorer les ignobles soupçons que semblent indiquer tes paroles. Je crains de les deviner et, si tu ne les étouffes pas sans les exprimer, j'ai peur de sentir mourir mon amour. Elle sortait, fière, droite, telle une reine offensée.
Je la regardai faire deux pas, songeant :
— Voilà, tout est fini. Elle s'enferme en son mensonge. Mon amour est mort.
Mais il se releva, celui dont j'affirmais la mort parce qu'un brusque choc l'avait renversé. Et il me souleva, me força à me dresser, me précipita vers la menteuse, me fit prendre sa main, la ramener dans cette pièce d'où elle ne devait sortir que justifiée par la confession. Elle me suivit, docile, avec un regard qui cherchait sur mon visage une marque de repentir et de confiance, avec des lèvres presque entr'ouvertes d'un sourire qui pardonne.
Mais ce n'était pas de honte repentante que je tremblais, c'était de colère.
— Ecoute, Gabrielle. Prends garde à ce que tu fais. Je sais — tu entends bien, n'est-ce pas ? — je sais que tu as été la maîtresse de Bertrand.
Elle demanda, très froide :
— Vous ne voulez pas me laisser retirer ?
Je lui serrai furieusement les poignets, je l'assis de force sur une chaise. Et je criai presque :
— Non, Madame. Pas encore. Bientôt. Quand j'aurai vu qu'il n'y a aucune sincérité à attendre de vous. Alors vous vous retirerez... Pour toujours.
Elle remua sur la chaise, comme si elle cherchait une position commode. Puis :
— C'est bien, Monsieur. Je resterai aussi longtemps que vous le désirerez. Je suis prête à subir tous vos outrages de paroles et de gestes.
Je m'agenouillai devant elle.
— Ah ! Gabrielle, pardon si je suis brutal. Je souffre tellement.
— Oui, dit-elle, je comprends que, si vous ne me croyez pas, vous devez souffrir.
— Oh ! ce n'est pas de ce que tu crois que je souffre. Je ne t'ai pas eue tout entière dans le passé ; nous n'y pouvons plus rien, je me résigne. Mais je souffre horriblement de ne point te posséder toute dans le présent. Donne-moi par ton aveu ce coin obscur de ton âme qui se refuse à moi.
Elle se tut, me retira la main que je lui avais prise. Je continuai.
— Je ne t'en veux de rien et je ne souffre de rien, que de ton silence et de ton mensonge. Tu me refuses quelque chose de toi, quelque chose que tu peux me donner, quelque chose que tu me dois. Et pour cela, depuis des années j'agonise, et pour cela, voici que j'ai peur de te haïr. Guéris ma haine naissante et ma longue douleur. Un mot suffit. Tu as été la maîtresse de Bertrand, n'est-ce pas ? Dis : oui.
Elle ne répondit point. Je repris.
— Tu ne peux pas le dire, parce que mes yeux, avides de ton âme, te regardent trop. Tiens, je ne te vois plus. Ma joue est contre ta joue et tes lèvres touchent mon oreille. Tout bas, vers celui qui t'aime, et qui ne verra point ta rougeur, et qui t'adorera davantage d'être sincère laisse échapper ce souffle : Oui.
Immobilité et silence.
— Le mot est trop difficile à sortir, ma pauvre petite. Va, je m'en veux beaucoup de te torturer. Mais je souffre trop. Il faut que je sache. Ou plutôt, je me trompe. Je sais. Il me faut ton aveu, qui t'absout. Ne dis rien. Donne-moi seulement un baiser qui voudra dire : Oui.
Son visage s'éloigna du mien.
Je me relevai :
— Ah ! menteuse, je te méprise. Je te méprise tellement que je n'oserai plus t'aimer, je l'espère.
A mon tour, je me dirigeai vers la porte.
A son tour, elle se leva, courut vers moi, me saisit la main, me ramena sur le théâtre de l'horrible combat. Et elle cria :
— Mais parle donc, grand fou qui t'obstines à te faire du mal et à me faire du mal. Regarde comme je pleure, et aie pitié de moi. Sens comme ils brûlent, tes yeux secs, et aie pitié de toi. Parle, parle.
Je dis, très froid :
— C'est à toi d'avoir pitié de nous. C'est à toi de parler.
Elle reprit, impérieuse :
— Parle. Explique ce qui te fait croire ces abominables folies, ce qui peu l'emporter sur ma parole. As-tu jamais remarqué un mensonge dans mes paroles ?
— Celui-ci suffit bien ?
— As-tu jamais remarqué dans ma conduite quelque chose d'obscur ou de secret ?... Parleras-tu ?
— Je te dis que je sais.
— Tu sais ! tu sais !... Vais-je me heurter longtemps à ce stupide « je sais » ? Comment veux-tu que je réponde à un « je sais » ?
— Et toi, pourquoi me laisses-tu me heurter et m'endolorir à ton stupide silence ?
— Moi, je me tais, parce que je n'ai rien à dire. Mais quelque chose a fait naître ton soupçon. Dis ce quelque chose. Je pourrai alors, sans doute, te montrer qu'il t'a trompé.
— C'est impossible. Je suis sûr... Et je ne suis pas ici pour discuter ma certitude qui est absolue. J'y suis pour attendre un aveu, — qui ne viendra pas, décidément. Adieu, Madame.
Elle me prit le bras.
— Tu ne sortiras pas comme ça. Ou bien je vais croire que tu regrettes d'avoir épousé une femme sans fortune.
Je m'indignai :
— Pourquoi dis-tu des choses que tu ne crois pas, que rien ne te donne le droit de croire ?
— C'est la question que je te pose depuis une heure.
Elle se reprit, attristée :
— Pas tout à fait, hélas ! Par malheur, je vois trop que tu crois. Quelque infâme calommie... Quel misérable a pu insinuer ?...
— Personne n'a rien eu à insinuer ni à affirmer. Je sais par moi-même.
— Que sais-tu ?
— Oh !... Assez, je vous prie. Vous le savez aussi bien que moi. Et je trouve cette conversation ridicule, puisque vous refusez d'avouer.
— Ah ! tu dis : ridicule. Moi, j'ai le droit de dire : odieuse. Et pourtant je ne m'indigne pas. Et je veux la continuer, l'horrible disecussion, la faire aboutir. Pour toi. S'il ne s'agissait que de moi, ma fierté m'enfermerait dans un silence de dédain, me défendrait de me justifier contre un lâche soupçon qui n'ose même pas se formuler, qui hésite et qui fuit à chacune de mes tentatives pour le prendre corps àcorps. Je m'éloignerais avec dégoût. Mais il s'agit de toi, mon pauvre ami, et je t'aime, et je veux tuer ta souffrance. Laisse-la sortir un instant, la bête ignoble qui te ronge le cœur. Qu'elle montre seulement la tête, et je l'aurai vite assommée.
Elle souriait légèrement, très sûre d'elle-même, maternelle comme lorsqu'elle disait à son fils : Fais voir ton bobo.
— Que veux-tu que je te dise ? Tu ne peux rien contre l'évidence. Je ne suis pas un imbécile, et je sais bien que tu n'étais plus vierge quand je t'ai épousée.
— Tu sais !... Qu'est-ce qui te fait croire ?...
— Tu m'irrites, à la fin. Je te dis que je sais, que ça se connaît... Mais suis-je naïf de te répondre ! Comme tu dois rire de moi !
— Si ça se connaît, tu sais que tu mens.
Je haussai les épaules :
— Voyons, assez. Tu sais mieux que moi que tu n'as pas eu le signe.
— Quel signe ?
— Le sang.
— Quel sang ?
— Oh ! mauvaise foi incarnée... Le sang que tu as perdu quand Bertrand t'a prise ; le sang qu'on perd toujours en perdant sa virginité.
Elle me regarda en un silence abattu. J'appuyai :
— Tu ne peux plus nier. Alors, pourquoi ne pas avouer ? Au reste, c'est toi que ça regarde. Avoue tout de suite, et je pardonne encore, malgré tes impudents mensonges. Mais dépêche-toi, ou tout est fini entre nous.
— Que veux-tu que j'avoue ? Je n'ai jamais connu d'autre homme que toi. Je ne comprends rien à tes paroles. Je ne sais pas. Tu dis que j'aurais dû perdre du sang. Je cherche à me rappeler si j'en ai perdu, en effet. Je ne trouve pas...
— Tu ne remontes pas assez haut dans tes souvenirs.
— ... Je me rappelle une souffrance vive; je ne sais plus s'il coula du sang.
— Je sais qu'il n'en coula pas avec moi et que, par conséquent, il en avait coulé avec un autre.
— Ah! tais-toi, tais-toi. Je t'en prie, tais-toi.
Et elle se prit à trembler, les yeux noyés toute secouée de sanglots.
— Tes larmes sont un aveu,dis-je, indulgent. Pour cet aveu, je te pardonne. C'est fini, nous n'en parlerons plus.
Et je voulus l'embrasser.
Mais elle me repoussa.
— Tu me crois coupable ? demanda-t-elle, comme quelqu'un qui s'effare devant une vision impossible.
— Oui, mais c'est fini.
— Non, ce n'est pas fini.
Elle s'agenouilla devant moi, me prit la main vite mouillée de ses larmes :
— Ecoute, mon grand Stani, je suis bien malheureuse. D'après ce que tu dis, je vois qu'une apparence serait contre moi. Et pourtant, encore une fois, sur notre amour, sur la tête de notre enfant, je te jure que je suis innocente. Dis que tu me crois, moi qui n'ai jamais menti, plutôt que cette apparence dont j'ignore la valeur ordinaire, mais qui, aujourd'hui, aussi vrai que je t'aime, aussi vrai que je suis chrétienne, ment.
Je voulus retirer ma main.
— Ah ! tu ne m'aimes pas, cria-t-elle, si tu n'as pas confiance en moi.
— Assez de comédie. Je te dis que la preuve est certaine, ne permet pas la moindre hésitation.
Elle se releva :
— Et mes paroles, permettent-elles d'hésiter ? Il me semble que ça se connaît, quelqu'un qui dit la vérité, et tu dois sentir que je ne mens pas... Tu as vu beaucoup de coupables. Y en a-t-il jamais eu un seul qui parlât comme moi ? Tu as vu des innocents accusés par de fausses apparences. N'est-ce point comme moi qu'ils parlaient ?... Ce n'est plus à ton amour ni à ta confiance que j'en appelle. C'est à ton expérience du Palais. Réponds, mon juge chéri.
Je me rappelai l'espion Hubert, et les protestations d'innocence de ce misérable, et leur épouvantable accent de sincérité, et la façon dont je m'étais expliqué cette sincérité réelle. Et je dis :
— Va, laisse parler ton âme d'autrefois.
Elle eut encore son vaste regard étonné. Je repris :
— Tous les coupable nient avec énergie. La torture avait raison. Elle seule peut arracher l'aveu.
Elle dit :
— Crois-tu que tu ne me tortures pas ?
Je continuais, pour moi-même, philosophant tout haut :
— Seulement, dès que la souffrance dépassait la force d'âme, l'innocent avouait comme le coupable. De sorte que la torture non plus ne parvenait pas à la preuve...Jamais un aveu ne prouve rien... L'aveu n'est pas un moyen de connaitre le vrai... C'est un premier châtiment à imposer au coupable ordinaire ; une purification qui permet de pardonner au coupable qu'on aime.
· · · · · · · · · · · · · · · ·
— Madame ! Madame !
Et de grands cris dans la maison, et des bruits affolés.
J'ouvre la porte :
— Qu'est-ce qu'il y a ?
La bonne, comme folle, .portait sur ses bras mon petit Stani.
Je regardais sans comprendre. Mais ma femme se précipitait.
— Qu'est ce donc ?... Tout mouillé... Mais il est mort !
— Ce n'est pas de ma faute, Madame.
Et la bonne commençait un récit justificatif.
Il m'échappa un mot qui était un cri d'affreuse douleur, cruelle, sans doute, mais inconsciente d'intensité.
— Vous aviez juré par sa vie, Madame.
Je m'acharnai à vouloir faire revivre le petit cadavre, à lui faire vomir l'eau qui l'asphyxia. Ma femme s'y efforçait aussi. Un médecin arriva bientôt, nous arracha à nos folles obstinations.