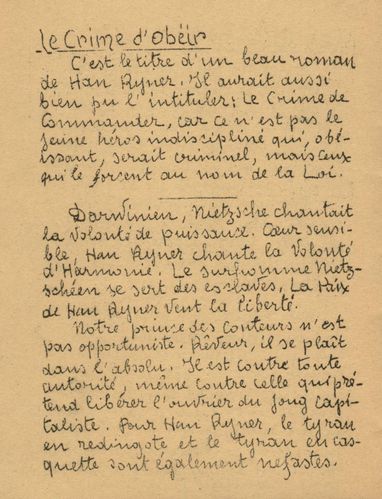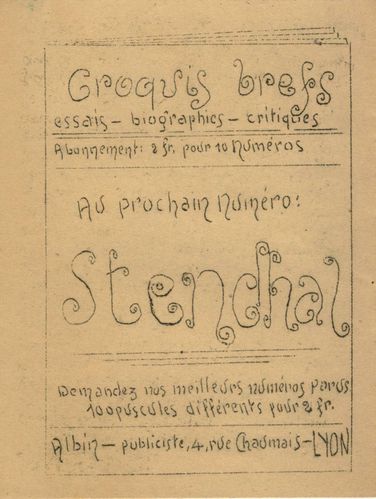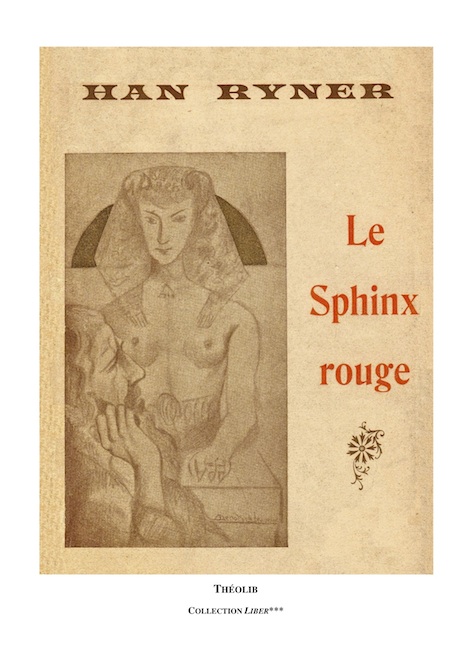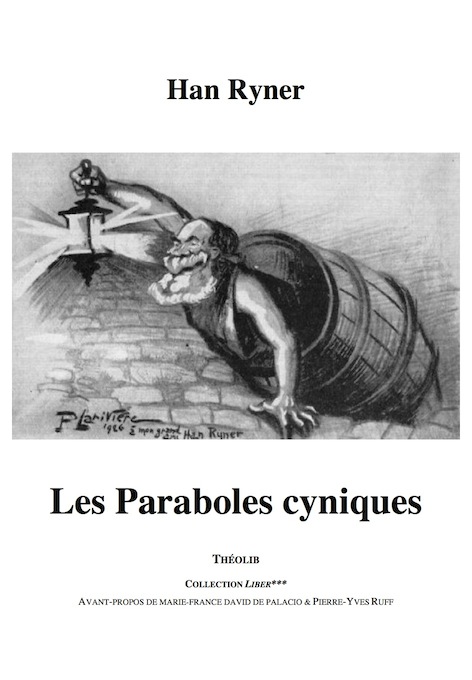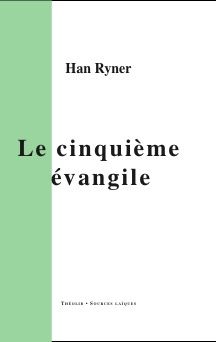Seconde partie de l'étude de Daniel Lérault. La première partie est ici.
C’était la mode à la « Belle époque des revues littéraires » de plagier et de dénoncer les plagiats, on en remplissait des pages. Je cite pour exemple d’affaire, en cette année 1912, celle produite dans la piquante revue Les Guêpes que dirigeait Jean-Marc Bernard (8). Ce dernier accusa Sylvain Bonmariage (9) d’avoir plagié vingt-six lignes lui appartenant et qu’il était coutumier du fait (10). C’était sans doute vrai, mais que de pantalonnades… Bonmariage était un jeune admirateur « zélé » d’Han Ryner et tous deux avaient vu paraître un de leurs textes dans la revue mais il n’y eut pas de suite Les Guêpes étant de l’autre bord que Les Loups…
La Paix, toute relative, revenue, on remit le débat sur la table et Marcello-Fabri fonda en 1919 La Revue de l’Époque dans laquelle il publie une grande enquête (11) « Du plagiat considéré comme un des beaux-arts » où l’on posait les questions : « Quel stratagème emploierez-vous pour lancer votre futur ouvrage ? Feindrez-vous le plagiat ou plagierez-vous réellement ? Où si vous répugnez à ces artifices, dites-nous ce que vous en pensez… » Une cinquantaine de littérateurs répondirent mais il manquait la réponse de Pierre Benoît le principal intéressé… On lira les réponses d’Han Ryner, de Florian-Parmentier… et je m’arrête à celle d’Octave Béliard non parce que la plus longue mais parce qu’elle « exprime d’intéressantes idées, beaucoup moins paradoxales qu’elles ne paraissent ». Le bon docteur Béliard professe en effet les mêmes idées qu’Han Ryner et résume son opinion : il n’y a pas de plagiaires. Il définit le plagiaire : « c’est un écrivain qui en vole un autre. Mais qu’est-ce qu’un écrivain peut voler à un écrivain ? Rien […] que ce qui est la propriété de cet écrivain : non pas les idées – les idées sont un fonds commun – mais seulement un mode personnel d’expression. En d’autres termes on ne saurait voler le sujet d’une œuvre, mais l’œuvre elle-même, parce que l’œuvre est à celui qui l’a faite, tandis que le sujet est à tout le monde. » Beliard regrette la vraie critique et s’en prend à celle improvisée des annonceurs qui ne recherchent dans un livre que ce qui s’y est glissé d’étranger et délaissent le visage ou restent indifférents au message de l’auteur. Enfin, il cite Virgile, Shakespeare, La Fontaine, Corneille, Racine, Molière, Diderot, « …ceux qui, pour employer le mot plagiat dans l’acception abusive où nous avons le tort de le prendre aujourd’hui, seraient d’illustres plagiaires. »
Cette enquête de La Revue de l’Époque « avait pour but de prévenir ce qui eut pu devenir une tentation et un danger pour les jeunes »…
Je lis, dans L’Âme Gauloise du 18 février 1923, un article de Jacques Faneuse :
Il vient de paraître dans une bonne revue régionaliste une lettre toute de finesse, d’esprit et d’ironie, comme seul Han Ryner pouvait l’écrire. Elle met, une fois de plus la question des plagiats au point, en démontrant qu’une similitude de titres, même complète, ne cause nullement un tort réciproque aux auteurs qui l’ont conçu, la personnalité du style et même de l’idée restant pleinement la propriété inimitable de l’écrivain.
La bonne revue c’est La Mouette, « revue idéaliste de littérature et d’art », de Julien Guillemard, parue de 1917 à 1926. Dans le numéro de février 1923, sous l’intitulé "Sans nom", Guillemard produit une lettre [voir ici], de son ami Ryner qui a rebondit au sujet d’une note concernant son roman Le Yacht sans nom. Les Sans nom ont une résonnance de noms biens réels : Barbey-d’Aurevilly « Une histoire sans nom », Maurice Level, pour « L’Ile sans nom » qu’il vient de publier, « L’Homme sans nom » de Ballanche… Ryner ajoute : « une similitude partielle de titre, même lorsque la rencontre me rapproche d’un écrivain que je méprise, ne m’a jamais troublé : Un de mes premiers romans s’appelle L’Humeur Inquiète et Paul Bourget a publié des vers sous le titre La Vie Inquiète. […] Le fameux père Enfantin a publié un petit livre qui s’appelle La Vie Eternelle. Je vais publier un roman qui s’appellera La Vie Eternelle. »
Le livre paraît le 9 janvier 1927 chez Radot et le docteur Béliard, évoqué plus haut, en rend compte dans Le Journal du Peuple du 28 mai. Je le cite car le document n’est pas facile d’accès :
En 1908 – il y a exactement 19 ans – deux jeunes gens dont l’un s’appelait Léo Gaubert, l’autre Octave Béliard, éditait à l’usage d’un public restreint, un livre de philosophie occulte auquel ils avaient travaillé ensemble durant cinq ans et dont le titre était Le Périple. On y pouvait lire, à la page 13, le passage suivant :
« Un enfant naissant est la vieillesse de sa lignée. Il porte sur le visage des stigmates de décrépitude, en lui des vestiges d’organes anciens, des ruines. C’est un vieil animal ; ses orteils se sont atrophiés par un trop long repos, ses plantes durcies, ses oreilles recroquevillées. Il est quelque chose de vénérable, d’adapté, de mille fois transformé au cours de la vie des espèces que sa propre vie résume. Sa pensée, comme un livre mille fois feuilleté, a des plis et des signets : les instincts. Il arrive au monde, bardé de ruse, armé de l’expérience des ancêtres… » etc.
En cette année 1927, il a paru un livre d’Han Ryner, La Vie Eternelle. On y lit (page 243) : « Nouveau pour les ignorants, le petit être est un si vieil animal. Cette vie éternelle a usé tous les réceptacles intérieurs, a usé jusqu’à notre forme. Que de signes de décrépitude, depuis ces orteils atrophiés au long repos dans les ténèbres, jusqu’à ce crâne froissé et ces oreilles recroquevillées… Pauvre enfant, chose neuve aux yeux naïfs, comme tu es désolant et vénérable. C’est presque écrasé que tu portes, sur le poids résumé de tant d’espèces, le fardeau condensé de tant d’incarnations humaines. Livre mille fois feuilleté, ton petit cerveau est plein de plis et de signets… » etc.
J’ai défini un jour pour moi-même Han Ryner : une éloquence servie par une merveilleuse mémoire. […] La Vie Eternelle compte 260 pages… De qui sont les 259 autres ?
[…] Et c’est encore pour contenter un besoin de justice qu’en ce dernier livre obscur et sans unité de ton, il embrasse la théorie hypothétique de la continuité de la vie dans la série des épreuves, et, sans être initié ni théosophe, flirte avec l’Initiation et la Théosophie.
Que vous m’êtes sympathique, cher vieux geai !
Han Ryner une nouvelle fois confondu de plagiat ! Il répond à Béliard le 30 mai, lettre publiée le 4 juin dans Le Journal du Peuple. J’extrais de la polémique :
De qui sont les 259 autres pages… Je le sais quelquefois… Une seule chose m’importe : avec ce que je crée, ce que je crois créer et ce que j’emprunte consciemment, je m’efforce de former un tout inédit et une harmonie un peu nouvelle.
Quand vous m’appelez « cher vieux geai » et si je vous appelais « sympathique jeune paon » à qui êtes-vous et à qui serais-je redevable ? A La Fontaine, probablement. Et lui ? A Phèdre ou à Esope ? Les documents ne permettent pas de remonter plus haut, mais, peut-être Esope était déjà un « cher vieux geai ».
Dès que mon imitation n’est pas un esclavage, je suis content. Je veux dire si ce qui me vient d’autrui me sert au lieu de me nuire. Question d’espèces. L’idée de la vieillesse de l’enfant et quelques détails qu’elle appelle nécessairement, je crois avoir bien fait de vous les prendre, puisque transportés dans un tout autre milieu et qui exige un accent différent, ils ne détonnent pas. […] Matériellement nous vivons tous les uns des autres. Et les plus originaux, ayant plus à dire, empruntent nécessairement, plus que les autres, moyens d’expression et détails expressifs. Je ne parle pas uniquement des classiques, qui avouent aussi délibérément que moi, mais on ne connaît pas encore, par exemple, tous les emprunts de Victor Hugo. Il a eu bien raison d’utiliser tout ce qui pouvait lui servir ; bien tort de cacher, comme une honte, cette vertu et cette puissance.
[…] Je vous ai fait, sympathique jeune paon, au moins un autre emprunt, plus large et plus précieux encore que celui que vous signalez. Et que vous aviez eu raison d’emprunter à d’autres. L’éternité courbe. Cette vieille idée admirable que Nietzsche a magnifiquement « pillée » aux Stoïciens, qui la tenaient d’on ne sait quel Orient, pourquoi ne l’auriez-vous point prise chez lui, ou chez ses fournisseurs ?
Octave Béliard réplique :
Le « cher jeune paon » est une riposte excellente et qui allait de soi, mon cher Han Ryner, bien qu’à cinquante ans… Mais quant à votre justification – très habile, j’en conviens (et n’ai-je pas toujours proclamé votre habileté ?) – elle s’appuie sur une équivoque, tout comme maint plaidoyer d’avocat. Vous enfoncez une porte ouverte en disant que la circulation des idées est libre et qu’un sujet appartient à tout le monde. Nous vivons tous, assurément, sur le même fonds, et très restreint. Rien n’appartient en propre à l’écrivain que l’expression qu’il a forgée ; mais cela c’est à coup sûr son bien et quand on le lui emprunte sciemment, volontairement, on fait – je vous demande bien pardon – un plagiat. Ecrivez si bon vous semble une Iphigénie ; vous ne serez qu’un auteur de plus à ajouter au nombre de ceux qui l’ont fait. Mais copiez un seul passage de Racine, à plus forte raison si vous en changez quelques mots pour déguiser votre emprunt, vous êtes indubitablement un plagiaire. Et si celui que vous pillez est un auteur obscur, c’est plus grave, parce que vous comptez sur son obscurité pour n’être pas découvert.
Maintenant, il vous est loisible de reprendre la question de plus haut et d’écrire une justification, voire une apologie du plagiat. Toutes les idées sont défendables et vous êtes un merveilleux avocat.
Le Prince des Conteurs ne pouvait en rester là. Le 11 juin il titre, à la page des Lettres du Journal du Peuple : « Soyons jeunes ne soyons pas enfants » :
La jeunesse de mon ami Octave Béliard est plus admirable encore que je ne croyais. Ah ! sa façon confuse de protester : « Bien qu’à cinquante ans je ne sois plus que relativement jeune »… Chez un écrivain subtil et qui a su parfois « donner un sens plus pur aux mots de la tribu », cet argument d’officier de l’état civil n’est-il pas ce qu’on pouvait attendre, si j’ose dire, de plus inattendu et, à la fois, de plus naïvement charmant et jeune ? Quelle jeunesse encore dans cette persuasion qu’on a raison de façon si absolue que seul peut vous contredire un habile et « merveilleux avocat » ? Ce confusionnisme n’est-il pas jeune aussi qui transporte sur le plan moral une question de pure esthétique ? Puisqu’il exige que je tienne compte de son âge, je déclare dès maintenant Octave Béliard beaucoup plus jeune que son âge.
Mais ne vais-je pas découvrir qu’il est plus jeune que tous les âges ? Chez ce critique, la manière de se présenter le travail du romancier ou du poète étonne par sa puérilité. Sérieusement, Béliard, vous me voyez occupé à un « démarquage » et à « changer quelques mots pour déguiser mon emprunt » ? Et mon cas vous semble d’autant « plus grave » que, délibérément, je choisis pour le piller « un auteur obscur », comptant « sur son obscurité pour n’être pas découvert ». Je n’ai jamais lu phrases d’une plus belle enfance indignée et rougissante.
Mes façons de me cacher sont infiniment plus naïves que celles de l’autruche. J’ai compris Octave Béliard dans mon service de presse, quand il a parlé d’une mienne publication postérieure, je me suis inquiété, l’ai prié de me faire signe s’il n’avait pas reçu La Vie Eternelle. Dès que j’ai su que son exemplaire ne lui était point parvenu, je lui en ai adressé un second et, me méfiant de la poste, l’ai confié, pour plus de sûreté, aux colis parisiens. On voit quelles précautions méticuleuses je prenais « pour n’être pas découvert ».
Octave Béliard me croira-t-il – s’il ne me croit pas, tant pis pour lui – si je lui explique que je n’avais sous les yeux, quand je le pillais, ni son livre, ni aucune note prise dans son livre. Oh ! je savais parfaitement d’où venait l’idée que j’exprimais. Il y avait souvenir, non simple réminiscence. Mais tout entier à l’application de l’harmoniser à mon contexte, je ne me préoccupais ni de démarquer ni de citer fidèlement.
La page de La Vie Eternelle supprime-t-elle la page du Périple ? Est-ce sur une page qu’on jugera l’un ou l’autre livre ? Quels enfantillages ! Faisons Octave Béliard et moi plus enfants que l’enfance. Incapables de songer à l’harmonie réalisée ou manquée, à la différence même des deux harmonies tentées, voici que nous accordons un prix énorme à la priorité. Eh bien ! où est mon crime ? Mon livre n’est-il pas daté deux fois : par le copyright et à l’adresse de l’imprimeur.
Ce n’est plus de l’idée qu’Octave Béliard réclame la propriété exclusive. Mais si, à exprimer la même idée, j’ai le malheur d’employer quelques mots semblables, je suis « un plagiaire », c’est-à-dire, sans doute, un voleur. Octave Béliard daigne m’accorder le droit de faire une Iphigénie après Racine. Mais « copiez un seul passage de Racine, à plus forte raison si vous en changez quelques mots pour déguiser votre emprunt, vous êtes indubitablement un plagiaire ».
Octave Béliard, vous qui êtes un lettré, comment avez-vous pu écrire ces lignes si jeunes sans vous demander quels hommes supérieurs vous attachiez à votre naïf pilori de brume ? Nul ne comptera combien les tragédies de Voltaire ou la prose d’Anatole France copient de passage de Racine. Or l’un et l’autre changent presque toujours quelques mots. Non point pour déguiser des emprunts, dont je les soupçonne d’être fiers, mais pour obéir aux nécessités de leur thème ou pour céder à une autre pente personnelle.
Rajeuni d’indignation, Octave Béliard va-t-il crier : « Au voleur » derrière Voltaire et Anatole France ? Qu’il se prépare à poursuivre de même tous les grands écrivains auxquels nous connaissons des prédécesseurs. Il m’en voudrait de lui rappeler les nobles pillages de Molière dans Cyrano de Bergerac ou de Virgile dans Ennius.
Je n’ai pas de Virgile sous la main et le vers d’Ennius m’empêche de retrouver le vers de l’Énéide ; je ne sais plus par quelles syllabes heureuses Virgile remplace l’onomatopée taratantara, mais tout le reste du vers est semblable :
At tuba terribili sonitu taratantara dixit.
Comme la trompette du vieux poète, Octave Béliard s’amuse à me crier aux oreilles un taratantara que sa jeunesse, sans doute, croit terrible.
L’imprudent ! Le voici condamné à avouer une erreur – ce qui est toujours noble mais n’est peut-être pas jeune – ou à condamner Virgile, Molière, Lamartine (O temps, suspend ton vol, est, il le sait, d’Antoine Léonard Thomas) et cent autres qui nous valent bien. S’il se résignait à ce dernier parti, j’aimerais mieux rester coupable à ses yeux avec tant de grands hommes que devenir, de la façon à quoi il consentirait alors, un innocent.
A lire l’un et l’autre on se croirait revenu dix ans en arrière les arguments de l’attaque et de la défense restant, à peu de chose près les mêmes. Quant à Octave Béliard on ne comprend pas bien son intervention lors même qu’il avait pris une position, dans La Revue de l’Époque, assez proche de celle d’Han Ryner. Sauf que là il y avait un cas concret et c’était lui-même le plagié : orgueil, vanité, enfantillages…
Ils le comprirent et tous deux restèrent de bons amis.
Allez, assez plagié pour aujourd’hui,
Puisse-t-il jaillir demain quelque lueur !
Daniel Lérault
(8) Jean-Marc Bernard (1881-1915). Il fonde Les Guêpes, revue maurassienne, en 1909 avec Raoul Monier. Il publiera un article critique, en février 1911, « En marge de deux livres de Han Ryner » auquel Ryner répondra dans le n° 2, 1911, de La Forge, « Soliloque ». J.-M. Bernard meurt au front en juillet 1915.
(9)Sylvain Bonmariage (1887-1966). Auteur prolixe, mémorialiste : La Messe des Oiseaux, Le Sang des Pharisiens etc. On lira son portrait d’Han Ryner dans Les Tablettes d’Alcibiade, son témoignage sur l’élection du Prince des Conteurs dans les Cahiers des Amis de Han Ryner n° 48, 1958.
(10)Les Guêpes, n° 30, janvier 1912, pp. 6-14
(11) La Revue de l’Époque, n° 22, décembre 1921 et n° 23, janvier 1922.