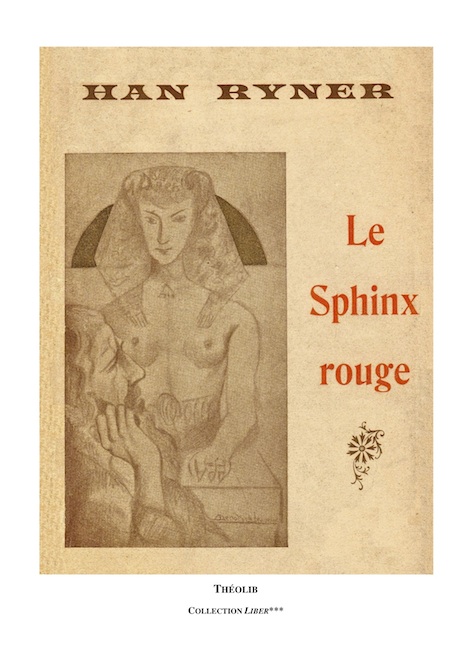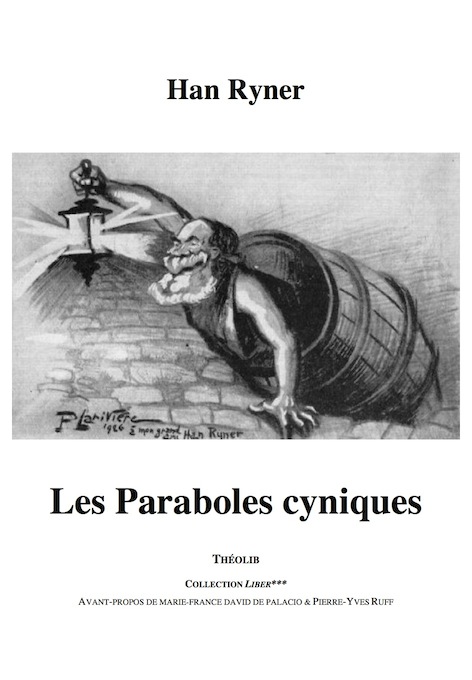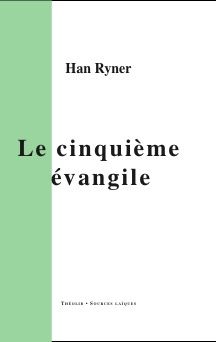Ce conte de Noël a été publié en 1913 dans pas moins de trois périodiques : le Courrier de France du 15 décembre, Le Lorrain (Metz) du 24 décembre et le numéro de Noël du Miroir !
Il a été repris dans le volume de Contes préparé par Louis Simon et édité en 1968, excellent ouvrage dont quelques exemplaires sont encore disponibles auprès des Amis de Han Ryner.
Le présent du berger
Conte de Noël
Devant l'étable où bêlait le troupeau, la petite maison touchait presque la mer. Sur le seuil s'amoncelait le sable fin où se mêlent les coquilles roulées. Et l'anse minuscule abritait la barque balancée comme un enfant qu'on endort.
C'était une solide barque pontée. Du nom familier que les Provençaux donnent à la Vierge, elle s'appelait la Bonne-Mère. Comme attirée par la caresse ou le défi des vagues, elle semblait toujours sur le point de partir en un élan vers les aventures.
Elle ne partait jamais.
Bernard Londas, le vieillard infirme qui habitait la maisonnette, passait le plus de temps possible dans la barque aimée et inutile. Du seul bras qui lui restait, il la soignait comme une mère adorée ou comme une petite fille qu'on n'est pas sûr de voir longtemps encore. Il lui parlait avec de puériles câlineries :
— Hein, pitchoune, tu voudrais courir sous le vent et ça te ferait plaisir de revoir un peu le large. Mais, tu le sais bien, ça ne se peut plus. Mon pauvre bras gauche, et rhumatisant, et sujet aux crampes, comment qu'il manœuvrerait la voile ou qu'il ferait marcher les rames ?
Souvent, les nuits d'été, il dormait dans la barque, sous les étoiles. Là, naguère encore, le sommeil retrouvait une douceur de jeunesse et le léger roulis berçait des songes délicieux, des songes de courses, de vent et de pêches extraordinaires.
Depuis dix ans, depuis « le malheur », il ne pouvait plus, il savait qu'il ne pourrait jamais plus tirer sur les cordes qui étalent ou replient la voile claquante; il ne pouvait plus, il savait qu'il ne pourrait jamais plus, sur la mer calme, agiter les rames comme des bras de nageur et faire glisser la Bonne-Mère, blanche, lente et harmonieuse comme un cygne. Mais depuis un mois, sa tristesse s'était alourdie en désespérance; depuis un mois, les rêves consolateurs ne revenaient plus.
Après ce qu'il appelait toujours d'un terme vague, « le malheur », après l'accident qui avait nécessité l'amputation du bras droit, Bernard Londas, privé de son métier de pêcheur, s'était demandé non sans angoisse comment il gagnerait sa pauvre vie. Il se sentait incapable de se plier aux domesticités. D'ailleurs, à son âge et avec son infirmité, quel maître aurait voulu de lui ? De petites économies, sans doute, mais qui fondraient si vite... Sagement, il les avait employées à l'achat de quelques moutons qu'il menait paître sur la colline. Mais il avait une grimace mécontente si un passant lui demandait :
— Comment va, berger ?
Au contraire, une lueur de plaisir, presque de fierté, s'allumait dans son regard si le passant disait :
— Eh ! vieux goéland, comment va la Bonne-Mère ?
Au commencement, à plusieurs reprises, on avait voulu lui acheter sa barque. Londas, d'ordinaire si doux et bon, avait reçu les offres avec colère, comme des injures. Tant qu'il vivrait, non, personne ne monterait cette Bonne-Mère qu'il ne pouvait plus monter. Il en était jaloux comme un vieillard est jaloux de sa jeune femme.
Pourtant, il y a un mois, vers la fin novembre, il avait eu peut-être devant une proposition nouvelle une seconde d'hésitation. Voici les circonstances qui l'avaient rendu peut-être hésitant une seconde.
La barque les Deux-Frères avait sombré dans une tempête et Marius Esclan, l'un des frères qui la montaient et auxquels elle devait son nom, s'était noyé. Pierre, le survivant, était veuf avec cinq enfants. Il avait recueilli sa belle-soeur, la Marie, chargée elle-même de trois enfants. et sur le point d'être mère pour la quatrième fois. Comment donner la becquée à tout ce petit monde maintenant que le gagne-pain était perdu ?...
Pierre était venu avec la pauvre femme, avec ses enfants maigres, avec les orphelins aux yeux rougis. Il avait dit à l'ancien pêcheur :
— La Bonne-Mère, à quoi elle te sert ?... Nous, elle nous sauverait. Vois-tu, il faut être bon pour les malheureux qui ne demandent qu'à travailler et à rester honnêtes. Il faut me la vendre ou me la prêter. J'ai pas d'argent pour te payer. Mais tu me connais, tu sais que je suis pas capable de faire perdre un centime même à un riche. Je te donnerai ta part de pêche.
Le vieillard avait eu un froncement de sourcils. Et il avait presque crié :
— J'ai pas besoin de ta pêche. Quand je veux manger du poisson, j'en prends à la nasse.
Il criait presque et sa voix était dure parce qu'une grande pitié, à la vue de ces êtres minables, touchait son coeur de brave homme et parce qu'il avait eu un moment presque peur de céder.
Il était furieux contre lui-même.
Et il criait tout à fait maintenant :
— Tu vois donc pas que j'en mourrais !
Puis d'un ton moins âpre :
— Je suis pas plus mauvais qu'un autre. Viens avec moi jusqu'à l'étable ; je te donnerai un agneau... Mais si tu veux pas que je me fâche pour toujours, me demande plus des choses qui se peuvent pas. Laisser un autre sortir sur la Bonne-Mère, autant arracher mon coeur de ma poitrine pour le mettre dans la tienne !
Depuis un mois, Bernard revoyait toujours la scène : tous ces pauvres visages décharnés, tous ces pauvres yeux gonflés. Il revoyait surtout la femme, cette Marie aux traits si douloureux qu'elle ressemblait à la Pieta de l'ancien couvent. Il avait beau chasser ces images comme des ennemis, elles revenaient obstinément. Quelque chose comme un remords les accompagnait. Il y avait en lui une manière de voix qu'il ne voulait pas entendre, qu'il faisait taire, à laquelle il disait des injures. Malgré tout, il n'était pas loin de l'entendre, la voix tenace. L'idée ne se formulait pas encore tout à fait dans son esprit que c'est mal de sacrifier des gens à son amour pour une chose. Mais elle se formulait presque, puisqu'il se répétait :
— La Bonne-Mère, c'est pas une chose ; c'est quelqu'un que j'aime. Et je sais pas bien si c'est ma femme ou ma fille.
Après la visite des affamés il n'avait jamais plus revu ces beaux rêves de navigation et de pêche, son unique joie depuis dix ans. Il avait beau refuser de se l'avouer, il sentait dans cette privation une punition du ciel.
Il essayait d'apaiser sa douleur et le ciel en multipliant les générosités. Il avait donné un second agneau. Plusieurs fois, il avait apporté à la Marie, dont le terme approchait, du poisson de ses nasses.
Comme il arrive sur la côte de Provence, il n'y avait pas d'hiver cette année-là. Sans doute, il eût été imprudent pour le vieillard de passer les nuits entières sur la Bonne-Mère. Mais le jour, quelle douceur de s'y étendre paresseusement au soleil. Même le soir, après la soupe, il semblait bon d'y venir fumer la pipe en rêvant.
Hélas ! le remords, de moins en moins vague, troublait ces humbles plaisirs.
Ce 24 décembre, le vieillard était vraiment soucieux. Il songeait à la Marie beaucoup plus qu'il ne l'aurait voulu. Il avait entendu dire que l'enfant ne pouvait plus tarder.
Il se disait :
— Ça serait drôle, tout de même, si ce petit venait cette nuit, comme l'enfant Jésus.
Le soir, après un repas moins léger qu'à l'ordinaire, — dame ! c'était le jour du « gros souper », — il avait bu un verre de vin cuit, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps. Ensuite, sa pipe à la bouche, il appelait des pensées qui ne voulaient pas venir et il en chassait qui revenaient.
A onze heures, c'était décidé, il partirait pour l'église. Au passage, il regarderait s'il y avait de la lumière et du nouveau chez les Esclan.
L'image du petit orphelin qui allait entrer dans une vie si sombre se mêlait dans l'esprit de Londas tantôt à l'image de la Bonne-Mère battue par la tempête et qu'il ne pouvait secourir, tantôt à la vision de l'enfant Jésus né dans une crèche pour aller, à travers les persécutions, vers le supplice de la croix.
Dimanche dernier, au sortir de la messe, Bernard s'était arrêté près du porche de l'église, devant la crèche où l'enfant rayonnait dans la paille radieuse, où le boeuf et l'âne soufflaient pour le réchauffer, où Marie et Joseph penchaient vers lui leurs douces figures protectrices. Cependant, sur les sentiers de la montagne de Bethléem, des bergers marchaient chargés de présents. L'un de ces bergers, qui portait un agneau sur les épaules, retenait longuement l'attention du vieillard.
Toutes les fois que décembre était revenu, il avait vu les mêmes santons dans les mêmes attitudes. Pourquoi l'intéressaient-ils à ce point aujourd'hui ?
Une vieille femme avait posé sur son épaule une main tremblante et familière ; puis, tandis qu'un doigt désignait précisément le berger qu'il regardait avec une émotion inexpliquée :
— Tu sais que maintenant tu lui ressembles...
A travers la fumée de sa pipe qui montait dans la nuit claire, Bernard se voyait sous la figure du santon, un agneau sur les épaules.
— Pour sûr, murmura-t-il, que j'apporterai à ce petit Jésus le présent du berger.
Il souriait, le remords calmé par cette pensée.
Mais la vieille plaie toujours saignante le faisait souffrir : jamais plus il ne pourrait manoeuvrer les rames ou la voile ; jamais plus il ne tirerait de l'eau profonde le filet magnifiquement lourd. Même retrouverait-il ce bonheur dans ses songes ?
Sa pipe finie, il s'endormait à moitié. Et son esprit, un peu engourdi, priait :
— Encore une fois, Seigneur, accordez-moi en rêve la grâce d'une belle pêche.
Il glissait doucement le long de la pente du sommeil. Puis il fut dans le gouffre du sommeil, dans ces profondeurs où, comme aux abysses marins, s'agitent tant de monstres et tant de merveilles.
... La Bonne-Mère, au large, voile éployée et vibrante comme une joie. Bernard n'est pas seul sur la barque. A l'arrière, debout, vêtu non d'un costume de marin, mais d'une longue robe blanche aux plis simples et droits, un homme comme on en voit dans les peintures et dans les rêves. Londas, en un tremblement reconnaît les yeux de puissance et de bonté, la face de douceur et d'amour adoucie encore par l'encadrement des cheveux blonds. C'est Jésus tel qu'il le voit chaque dimanche dans le tableau qui orne le fond de la vieille église.
Bernard Londas regarde le Christ avec un mélange de bonheur et d'effroi.
Un doigt qui semble fait de lumière approche de son épaule veuve, touche la place où, après l'accident, il fallut couper le bras. Miracle ! l'infirme a ses deux bras. Et le vieillard redevient fort et hardi, le jeune homme dont il se souvenait à peine.
En quelle allégresse il manoeuvre sa barque. Jamais il n'a joui aussi complètement de sa force, de son adresse et des splendeurs changeantes des eaux.
Ses yeux sont vraiment des yeux de miracle. Quelle lumière enchanteresse illumine la mer jusqu'aux profondeurs les plus secrètes ? Ah ! comme Bernard les aime en ce moment ces herbes marines plus fines que les gazons de nos jardins, plus soyeuses que la mousse au pied des chênes et ces varechs semblables à des chevelures renversées, souples et lourdes, et toute cette flore d'un éclat métallique, et tous ces coquillages aux couleurs vivantes de fleurs...
— Une mer de paradis ! proclame l'extase du vieillard rajeuni.
Prairies et forêts sont peuplées par le troupeau innombrable, glissant et sinueux des poissons dont les écailles sont de la lumière de tous les éclats et de toutes les couleurs.
Bernard jette le filet. Jamais richesse plus lourde ne fut livrée par la mer généreuse.
Son âme est un cri où se mêlent l'éblouissement présent et les souvenirs éblouis d'Evangile :
— La pêche miraculeuse ! C'est la pêche miraculeuse !
Mais le Christ, un peu oublié, fait entendre sa voix :
— Que feras-tu de ces poissons que tu ne peux manger ?
— Je les donnerai, Seigneur, je les donnerai à ceux qui ont faim.
Le Christ a l'air sévère maintenant comme lorsqu'il parlait aux scribes et aux pharisiens. Son doigt, qui semble fait de ténèbres, touche le bras miraculeux qui disparaît. Bernard se retrouve manchot et vieux, et faible. Et le Christ interroge avec l'accent terrible qu'il aura sans doute au jugement dernier :
— Que feras-tu de la Bonne-Mère que tu ne peux manoeuvrer ?
L'émotion trop intense réveille le dormeur.
... Pendant qu'il se secoue et, de sa pauvre main unique, frotte ses yeux, la cloche de l'église, là-haut, se met à sonner. Le vieillard tire d'une poche sa grosse montre d'argent; à la clarté de la lune et des étoiles, il constate :
— Onze heures, il faut partir.
Il entre dans la maison, met sa veste des dimanches puis se dirige vers l'étable.
Mais il n'ouvre pas la porte derrière laquelle dort le troupeau. Et, secouant ses épaules courbées, en une brusque fierté redressant son vieux corps :
— Je suis pas un vrai berger. Je suis un vieux pêcheur. C'est pas des agneaux que les gens de mer donnent au petit Jésus.
Il partit les mains vides.
En passant devant la maisonnette où s'entassait la misérable tribu des Esclan, il fut ému, il ne fut pas étonné d'apercevoir de la lumière, d'entendre les vagissements d'un enfant.
Il poussa la porte. Au fond, sur un lit, l'accouchée était pâle comme une morte. Pierre tournait gauchement dans la pièce. Une vieille femme — celle-là même qui avait remarqué la ressemblance de Bernard avec le santon — tenait l'enfant dans ses mains expertes.
Elle se tourna à demi vers Londas.
— Cette année, dit-elle, c'est ici la messe de minuit.
— Moi aussi, si on ne me met pas à la porte, répondit le vieillard.
La Marie le regardait avec des yeux étranges où il y avait comme une folie d'espoir, comme une folie d'angoisse. Elle ressemblait extraordinairement à la Vierge en ce moment, non pas à la Vierge jeune qui se penche sur l'enfant radieux, mais à la mère de douleur dont le coeur est percé de tant de glaives.
Bernard dit :
— Je viens donner quelque chose au petit Jésus qui vient de naître.
Et frappant sur l'épaule de Pierre :
— La Bonne-Mère est à toi, et à la Marie, et à tes petits, et aux petits de la Marie. Je vaux plus rien pour la manoeuvre. Mais je suis pas gênant et, par temps calme, dis, tu m'emmèneras bien dans ta barque.